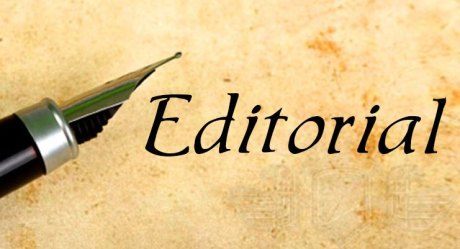Alors que le Bénin recule encore dans le classement mondial de Reporters Sans Frontières, la responsabilité des journalistes eux-mêmes est plus que jamais questionnée. À trop se taire, la presse béninoise risque de perdre sa raison d’être.
Le 3 mai dernier, comme chaque année à la même date, le Bénin a célébré, à l’instar des autres nations du monde, la Journée mondiale de la liberté de la presse. Un rendez-vous qui, au-delà des discours, coïncide toujours avec la publication du classement mondial de la liberté de la presse par Reporters Sans Frontières (RSF). Une fois de plus, notre pays figure en zone rouge. Le Bénin a encore perdu 4 places, passant de la 89e position en 2023 à la 93e en 2024. Une régression continue depuis 2015, qui soulève bien des interrogations.
Nombreux sont ceux qui pointent du doigt les restrictions politiques, les lois répressives ou les pressions économiques. Mais dans cet éditorial, je souhaite m’arrêter un instant sur un angle souvent oublié : la part de responsabilité des journalistes eux-mêmes dans cette dégringolade du quatrième pouvoir.
« La liberté de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas », disait Jean-François Kahn, journaliste et essayiste français. Cette phrase résume, à mon sens, l’essence même de la liberté d’expression. Comme lui, plusieurs aînés, figures respectées de la profession, s’accordent à dire que la liberté d’expression existe toujours au Bénin, mais qu’elle est tout simplement sous-exploitée, voire abandonnée, par ceux qui devraient la faire vivre.
Lors de formations animées par d’éminents journalistes béninois — je pense à Ricard Magnidet, ancien conseiller à la HAAC, ou François Awoudo, actuel secrétaire général de l’institution — le constat est souvent le même : les journalistes se censurent eux-mêmes, par peur ou par confort. Ces doyens estiment que la rigueur dans le respect de la déontologie protège encore, quelles que soient les pressions.
À plusieurs reprises, nous avons tenté d’argumenter. Nous avons affirmé que nous n’étions plus aussi libres d’écrire ou de commenter tous les sujets comme ils le faisaient autrefois. Mais inlassablement, nos aînés nous ont opposé une vérité dérangeante : nous avons renoncé à notre rôle par manque de courage ou de professionnalisme. En d’autres termes, nous avons déserté nos responsabilités, préférant les faux-fuyants à l’engagement.
Aujourd’hui, la course effrénée au sensationnel et à la viralité pousse certains confrères à brader les fondamentaux du journalisme. L’émergence des réseaux sociaux n’a fait qu’aggraver les dérives : confusion entre information et opinion, précipitation, désinformation…
Et pourtant, l’espoir n’est pas mort. À la tête de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), nous avons aujourd’hui un ancien journaliste, Édouard Loko, fin connaisseur de la profession, qu’il a servie sous le régime révolutionnaire comme dans l’ère démocratique. Fort de son expérience, il a promis de « remettre l’église au milieu du village » — c’est-à-dire, restaurer l’ordre, le respect des textes, et la rigueur professionnelle.
Comme lui, je reste convaincu que le salut de la presse béninoise repose encore dans les micros, les caméras et les plumes de journalistes vrais. Il nous revient, collectivement, de reprendre notre place, de redonner du sens à notre mission, et de prouver que la liberté de la presse ne meurt jamais… tant qu’il reste des journalistes pour s’en servir.
✍️ Moubarack ASSOUMBOLO